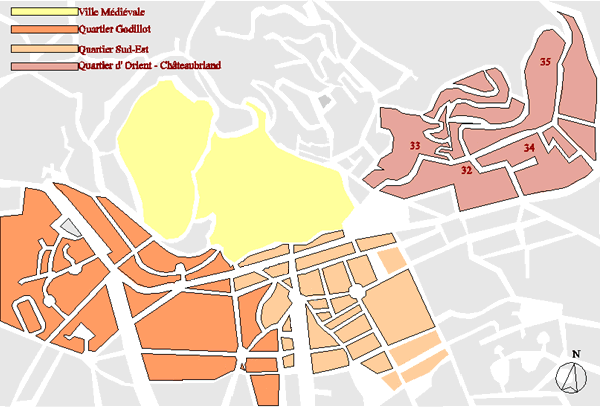 |
|
| 32 - Villa
Tholozan - 50, rue Alphonse Denis
33 - Villa Léon-Antoinette - 19, boulevard d'Orient 34 - Villa Ker-André - 8, boulevard Châteaubriand 35 - Hôtel Châteaubriand - 17, boulevard Châteaubriand |
Le quartier d'Orient-Châteaubriand |
C'est sous l'impulsion d'Alphonse Denis que commence l'extension sur la colline du Venadou, à l'est de la ville médiévale. Alphonse Denis, Hyérois d'adoption, maire de la ville de 1830 à 1848, possédait un château sur l'actuelle place Clémenceau (détruit dans les années 1950) dans lequel il recevait toutes les célébrités de passage. A partir de 1850, il encourage le lotissement de la colline sur laquelle il possédait des terres. C'est le début du quartier d'Orient avec la construction des villas Venadou, Léon-Antoinette, Saint-Georges ou Marie-Thérèse. A la mort en 1879 de Gaspard Van Bredenbeck de Châteaubriand, qui possédait une villa et des terrains au sommet de la colline, ses enfants divisent et vendent ses propriétés. Elles font l'objet d'une opération immobilière sous l'impulsion de Joseph Tagnard. Des villas vont se construire, la Villa Châteaubriand, détruite, fait place à l'hôtel du même nom en 1889. Dans un guide de 1906, il est dit que « le quartier Châteaubriand est le plus agréable, le plus abrité contre les vents, celui où se trouvent les plus riches habitations ». |
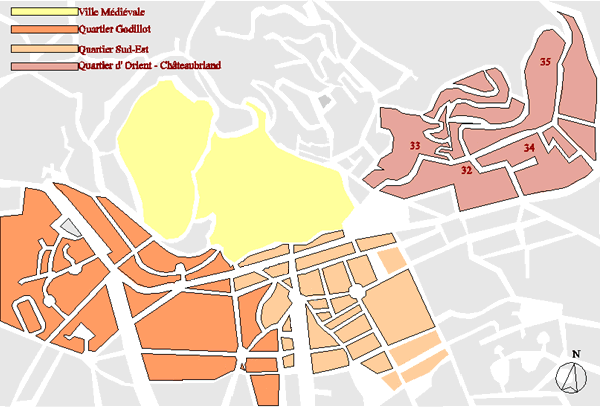 |
|
| 32 - Villa
Tholozan - 50, rue Alphonse Denis
33 - Villa Léon-Antoinette - 19, boulevard d'Orient 34 - Villa Ker-André - 8, boulevard Châteaubriand 35 - Hôtel Châteaubriand - 17, boulevard Châteaubriand |
 |
32
- Villa Tholozan - 50, rue Alphonse Denis
Construite pour le duc de Luynes en 1858, la villa passera par héritage à la marquise de Tholozan quelques années plus tard. C'est indéniablement l'une des plus anciennes et des plus remarquables villas d'Hyères par le soin apporté à son exécution aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La personnalité de son maître d'ouvrage n'y est pas étrangère. Le duc faisait partie des proches de Charles X, mais c'est en sa qualité d'archéologue qu'il a connu une certaine renommée. Directeur adjoint du musée des Antiquités Grecques et Egyptiennes, il s'est distingué par des recherches sur l'histoire de la polychromie antique, menées lors de voyages en Grèce, en Syrie et en Asie. |
La villa est vraisemblablement l'oeuvre de Frédéric Debacq (1800-1892), architecte de renom à l'époque, qui l'avait accompagné dans ses voyages archéologiques et avait participé aux travaux de restauration du château de Dampierre (autre propriété du duc), avec des artistes aussi célèbres que Charles Garnier, Ingres ou Rude. Bien qu'Amédée Aufauvre en 1863 la définisse comme « l'un des types les plus élégants de la villa provençale » notre perception actuelle y verrait, plutôt qu'un exemple de régionalisme, un beau morceau d'architecture classique à tendance italianisante. La villa semble mise en scène au-dessus d'un jeu de terrasses et volées d'escalier. Contrairement aux constructions plus tardives, elle est entièrement en pierre de taille de diverses provenances. Les horizontales semblent dominer : deux étages de sept travées au-dessus d'un soubassement à bossages et baies en plein-cintre à la manière des palais italiens. Cependant un accent très fort est mis sur l'avant-corps central : porche monumental surmonté d'une terrasse à balustres, troisième niveau rappelant un arc triomphal couronné d'une balustrade à pots à feu. La distribution intérieure est héritée de l'architecture classique. Une vaste cage d'escalier dessert au premier étage l'enfilade des pièces de réception au sud, dont un grand salon ouvert par trois grandes baies vitrées donnant sur une terrasse surplombant la plaine et la mer. C'est déjà ici le modèle de la résidence de villégiature qui prime, avec la recherche du maximum d'ensoleillement et de vue par le biais de larges ouvertures et de terrasses. Le parc était également traité avec soin et l'on y notait la présence d'un jardin exotique fort riche. Dans les journaux de l'époque la construction de la villa du duc de Luynes a fait figure d'événement malgré le jugement un peu sévère de Georges Sand en 1861: « la villa d'Albert de Luynes est jolie, manque d'ombrage, c'est trop neuf et puis c'est trop sur la route dans la poussière. ». |
|
 |
33
- Villa Léon-Antoinette - 19, boulevard d'Orient
L'architecture aristocratique et classique de la Villa Tholozan influencera dix ans plus tard la demeure d'un autre aristocrate érudit, Napoléon Bourgeois de Mercey. Fils d'un écrivain, peintre de paysage et directeur des Beaux-Arts, Napoléon de Mercey se passionne pour la géologie. C'est afin d'étudier « la division de la formation cristalline des Maures » qu'il vient à Hyères en 1866. Il y restera, épousant la fille du pharmacien Vérignon, futur maire d'Hyères. |
Le
couple réside à Paris mais fait construire à Hyères
une résidence de villégiature en 1870. A cause d'ennuis financiers
et du fait que la maison, de mauvaise qualité, exige déjà
des travaux de réparation très coûteux, de Mercey est
amené à la vendre en 1892 à l'ordre de Saint-Sulpice
qui, après l'avoir agrandie, la transforme en maison de repos sous
le nom de Villa Henri-Joseph.
|
|
| Autres images | |
 |
34
- Villa Ker-André - 8, boulevard Châteaubriand
A la mort de Joseph Tagnard, promoteur du quartier Châteaubriand vers 1890, sa veuve continue son oeuvre. Elle demande en outre à l'architecte Chapoulart de construire pour sa famille une grande villa moderne et confortable,réalisée en 1895. Prévue pour abriter une domesticité importante, elle s'organise selon une double circulation. Un escalier de service à l'est relie les cuisines et les communs, situés au sous-sol, aux étages nobles et dessert les chambres des domestiques sous les combles. L'escalier d'apparat à l'ouest s'arrête au premier étage. |
C'est une villa entièrement tournée vers la lumière et le soleil : pièces au sud, multiplicité des ouvertures, bow-window, terrasses, loggia. La façade sud, sur jardin, est la mieux traitée. Le parti d'horizontalité et de régularité est égayé par les balustrades des terrasses, l'asymétrie des deux ailes latérales, le décor de céramique ou l'agrafe sculptée d'une tête d'enfant surmontant la loggia. |
|
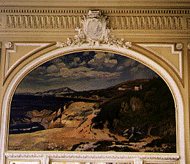 |
35
- Hôtel Châteaubriand - 17, boulevard Châteaubriand
L'Hôtel Châteaubriand a été construit à la fin des années 1880 lors du lotissement du domaine de Van Bredenbeck de Chateaubriand, sur l'emplacement de la villa détruite. C'est le dernier des grands hôtels construits à Hyères, l'un des plus luxueux. Il semble avoir attiré une importante clientèle anglaise. En témoigne un guide publicitaire du début du XXe siècle, rédigé en anglais, axant sa publicité sur sa situation (orienté au sud avec vue sur les Iles d'Or et la mer, au sommet d'une colline, dans un parc privé planté de pins, de mimosas et d'eucalyptus, loin du bruit et de la poussière des rues) et sur ses prestations (ascenseur, chauffage central dans toutes les chambres, court de tennis etc...). |
|
Sa
période d'ouverture va alors d'octobre au 15 mai et il propose 90
chambres. Réquisitionné pendant la guerre, il n'a cependant
pas souffert de dégradation. C'est le seul des grands hôtels
d'Hyères qui ait conservé ses décors intérieurs
néo-Louis XVI dans le salon et la salle à manger. Le salon
est largement ouvert au levant par un vaste bow-window. Il communique avec
la salle à manger par une porte vitrée flanquée de
deux colonnes ioniques en marbre qui sont des remplois de la villa disparue.
Celles-ci soutiennent un linteau à motifs de gypserie : feuilles
d'acanthes, urne, rinceaux, oves. Au revers, dans la salle à manger,
cette porte s'inscrit dans une baie en anse de panier, ornée d'une
peinture à l'huile sur toile marouflée signée «
STANY SASSY au Pradon Carqueiranne ». Elle représente des
putti en grisaille en médaillon et des coupes de fleurs et de fruits.
La porte est cantonnée par deux baies aveugles de taille identique,
également décorées de toiles marouflées du
même peintre et représentant des paysages de bord de mer.
Sur celui de droite, on reconnaît le château de San Salvadour
situé en bordure du rivage hyérois.
|
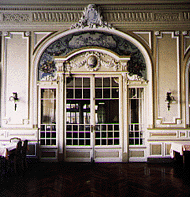 |
|