Le quartier Godillot |
Si le quartier situé à l'ouest de la ville ne porte pas officiellement ce nom, c'est cependant à Alexis Godillot (1816-1893) qu'il doit sa physionomie actuelle. Qui est Alexis Godillot ? D'origine modeste, il s'enrichit en tant que « fournisseur aux armées » essentiellement grâce à la guerre de Crimée (1853) pendant laquelle il équipe les troupes en tentes, selles et surtout chaussures montantes auxquelles il laissera son nom. Après la révolution de 1848, il avait aussi créé une entreprise d'organisation de fêtes publiques qui se développe sous le Second Empire. Il devient « entrepreneur officiel des fêtes » chargé entre autres de la décoration d'apparat de chacune des villes que traversait Napoléon III. Son goût pour l'aménagement trouve un terrain d'action plus durable tout d'abord à Saint-Ouen où il a des usines et des tanneries et dont il devient maire. Il y conçoit projets d'urbanisme et villas élégantes. Il découvre Hyères dans les années 1860, s'y installe et entreprend sa modernisation, son extension et le développement du tourisme hivernal. On peut dire qu'il mène une action de promoteur « éclairé ». L'achat en 1864 de l'Hôtel des Iles d'Or est suivi du début de l'urbanisation de la sortie ouest de la ville, au nord et au sud de la route de Toulon. Les plans et devis des nouveaux quartiers sont signés par Jean-Baptiste Maurel, architecte de la ville en 1865. Puis, c'est l'ouverture de l'avenue qui porte actuellement son nom et le lotissement des terres provenant de la succession de Beauregard avec la création des avenues de Beauregard, maréchal Galliéni, E. Millet, P. Brossolette. Le tracé des rues suit certains principes d'urbanisme : voies rayonnant à partir de ronds-points, pattes d'oie... Ces avenues se bordent peu à peu de villas. Le lotissement est le fruit d'un accord entre Godillot et la municipalité. Il offre le terrain de la rue à la ville qui effectue les travaux de viabilité et revend quant à lui les parcelles à bâtir. Sa préoccupation va aussi à l'ornement urbain avec la réalisation de fontaines qui proviennent des fonderies du Val d'Osne dont il est actionnaire. C'est le cas par exemple de la grande fontaine de l'avenue Godillot |
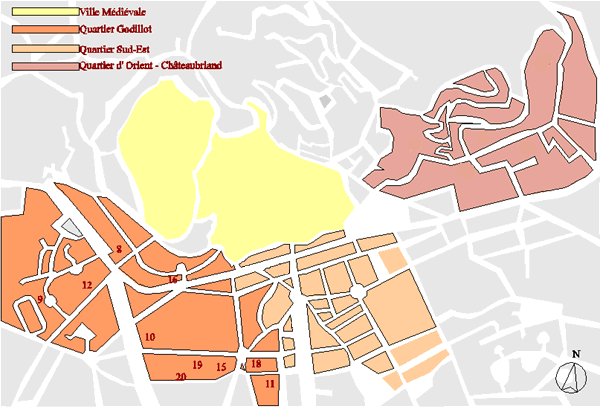 |
08 - Maison Saint-Hubert - 70, avenue des Iles d'Or |
 |
8 - Maison Saint-Hubert - 70, avenue des Iles d'Or
En 1882, Godillot fait réaliser par Pierre Chapoulart sa propre maison. Il s'agit en fait du réaménagement de deux villas existantes et de leur transformation en un vaste hôtel particulier comportant au rez-de-chaussée les communs, au premier étage, le grand salon, le jardin d'hiver, la salle à manger, la cuisine et des chambres, au second un autre appartement et la salle de billard, un atelier étant aménagé sous les combles. |
 |
9 - Manège d'Alexis Godillot - 22, avenue Victor Hugo
Parallèlement à l'aménagement de sa maison, Godillot demande à Chapoulart des plans pour l'édification d'un château devant se trouver entre la rue J. Natte et la rue des Villas (V. Hugo). De ce château, seuls seront réalisés les écuries et le manège pour le fils de l'industriel, en 1882. Les bâtiments s'organisent selon un plan en U autour d'une cour carrée : salle de manège et, de part et d'autre, écuries surmontées des chambres du personnel. Un grand soin est apporté au décor intérieur et extérieur. On peut noter en particulier les figurations rappelant la fonction de l'édifice : chevaux, fers à cheval, ainsi que le décor de céramique. Le manège a été transformé en manufacture d'articles en aluminium dans les années 1930. La cour a été fermée à ce moment là. (Il ne se visite pas.) |
 |
10 - Eglise anglicane Saint-Paul's Church 22, avenue Andrée de David Beauregard A partir de 1825-1830, on note à Hyères une importante communauté protestante composée presque essentiellement d'hivernants étrangers. Ils se réunissent alors chez Georges Stulz, tailleur allemand élevé au rang de baron et bienfaiteur de la ville d'Hyères, dans le château qu'il avait acquis (futur château Denis). Au milieu du siècle, sous l'impulsion d'Alphonse Denis, maire d'Hyères, dont l'épouse est anglaise, un véritable lieu de culte est construit avenue des Iles d'Or, en 1853. Il est alors utilisé par toutes les communautés et s'avère vite trop petit. En outre, les Anglais souhaitent avoir leur propre lieu de culte. |
En 1867, ils font édifier une nouvelle église (avenue Joseph Clotis, sur l'emplacement de l'actuelle Galerie des Palmiers) jusqu'à ce que Godillot leur fasse don d'un terrain en 1883 dans le quartier qu'il est en train d'aménager et d'une somme d'argent pour la construction d'une église plus monumentale. Elle est consacrée en 1884 par l'évêque de Gibraltar et sera utilisée par la communauté anglaise jusqu'en 1950. C'est maintenant un lieu culturel municipal. |
|
 |
11 - Ecole Anatole France - rue Michele
La construction d'édifices publics accompagne l'aménagement des nouveaux quartiers, ainsi celle de l'école Anatole France, datée de 1888-89 et oeuvre des architectes Charles Maurel et Edouard Angeli. Cet ensemble en brique et pierre présente un plan symétrique, composé d'un vaste préau flanqué de deux ailes comportant les salles de classes et de deux villas attenantes pour le directeur et le sous-directeur. L'élément le plus remarquable est le préau tant par sa monumentalité que par la qualité du décor de ses façades : colonnades, niches à frontons, couronnes de lauriers et de feuilles de chêne tressées etc. Cet édifice, qui tient à la fois de la basilique antique et de l'arc de triomphe, témoigne bien de l'ambition des visées assignées à l'instruction publique sous l'impulsion de Jules Ferry. |
 |
12 - Villa Mauresque - 2, avenue Jean Natte
Pour Godillot, Chapoulart réalise en 1881 la Villa Mauresque destinée à la fois aux réceptions données par l'industriel mais aussi à la location aux hivernants à qui elle propose un cadre exotique propre à assurer le dépaysement demandé à une résidence de villégiature. Les villas orientales étaient par ailleurs à la mode sur la côte méditerranéenne qui offrait un environnement végétal approprié (orangers, palmiers, yuccas). En témoignent les exemples de Cannes, Marseille ou Toulon (du même Chapoulart). |
|
La tradition de l'orientalisme était un héritage du XVIIIe siècle repris à la fin du XIXe siècle par le colonialisme triomphant. La Villa Mauresque utilise le vocabulaire ornemental orientaliste : arcs outrepassés, merlons, belvédère-minaret à coupole, carreaux de faïence. |
 |
|
 |
15 - Villa Tunisienne - 1, avenue Andrée de David Beauregard En 1884 Chapoulart réalise pour lui-même, dans le même style, une villa qui abrite également son agence. Mais ici il organise les pièces de réception du premier étage autour d'un patio. Façade sur rue et façade sur jardin présentent un décor de ciment moulé rehaussé de polychromie et de carreaux de faïence. L'ensemble y est traité avec beaucoup de soin. |
Cet immeuble de luxe conçu vers 1880 par Chapoulart pour Godillot dont il porte le monogramme au-dessus de l'entrée, abritait le siège de l'English Bank. C'est un bel immeuble de quatre étages dont le dernier niveau est occupé par une véranda sur les deux façades. Il tire son nom de la tour en demi-hors-oeuvre qui adoucit l'angle sud-est. Le décor est éclectique : grecque en carreaux de céramique, corniche, pilastres colossaux ioniques encadrant la porte d'entrée surmontée d'une tête féminine. Villa des années 1880 qui constitue un exemple tout à fait représentatif de l'architecture de villégiature de la fin du siècle. Légèrement en retrait par rapport à la rue dont elle est séparée par une clôture à portail architecturé, sa façade est d'une sobriété toute classique : cinq travées ordonnancées avec accent mis sur la travée centrale surmontée d'un fronton flanqué de volutes. Une façade soignée donne également sur le jardin qui se développe à l'arrière.

16 - La Tour Jeanne - 42, avenue des Iles d'Or

18 - Villa Beauregard - 11, avenue Ernest Millet

19 - Villa La Criquette
7, avenue Andrée de David Beauregard
Le lotissement du quartier se poursuit dans les années 1930. L'architecture devient alors d'inspiration plus régionaliste avec l'emploi de la tuile creuse, de la génoise en décor, de la terre cuite vernissée inspirée des pigeonniers. Ici, le portail architecturé est totalement en harmonie avec le traitement de la maison.

20 - Immeuble Le Régent
18, avenue François Arène
Immeuble réalisé par Lucien David dans les années 1950 et qui présente un bel exemple d'architecture moderne avec équilibre des lignes et usage du porte-à-faux. La présence de pierre de taille locale apporte ici une touche de régionalisme.

7, avenue Andrée de David Beauregard
Le lotissement du quartier se poursuit dans les années 1930. L'architecture devient alors d'inspiration plus régionaliste avec l'emploi de la tuile creuse, de la génoise en décor, de la terre cuite vernissée inspirée des pigeonniers. Ici, le portail architecturé est totalement en harmonie avec le traitement de la maison.

18, avenue François Arène
Immeuble réalisé par Lucien David dans les années 1950 et qui présente un bel exemple d'architecture moderne avec équilibre des lignes et usage du porte-à-faux. La présence de pierre de taille locale apporte ici une touche de régionalisme.